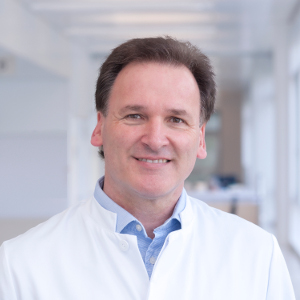Spécialistes en Descente de la vessie
6 Spécialistes trouvés
Informations sur le domaine Descente de la vessie
Qu'est-ce qu'un prolapsus vésical?
On entend généralement par prolapsus vésical le déplacement vers le bas de la vessie. Il résulte généralement d'un prolapsus des organes génitaux féminins et touche donc presque exclusivement les femmes. Comme les parois antérieure et postérieure du vagin sont reliées aux organes voisins, la vessie et l'intestin, par différents tissus conjonctifs, le déplacement du vagin vers le bas peut également entraîner un affaissement de ces organes. La vessie est le plus souvent touchée, ce que l'on appelle en médecine une cystocèle.
Le prolapsus de la vessie est principalement dû à une faiblesse des muscles du plancher pelvien. Les muscles du plancher pelvien s'étendent entre les os du bassin et maintiennent et stabilisent ainsi principalement des organes tels que la vessie et l'utérus vers le bas.
Ces muscles ont tendance à être moins développés chez les femmes et s'affaiblissent également avec l'âge. De plus, ils sont sollicités par une forte pression et peuvent être endommagés lors de l'accouchement.
Facteurs de risque
En principe, le prolapsus de la vessie est dû à un affaiblissement des muscles du plancher pelvien et des tissus conjonctifs environnants. Bien que la cause exacte de cette faiblesse musculaire ne puisse généralement pas être identifiée avec précision, certains facteurs peuvent favoriser l'apparition d'un prolapsus de la vessie.
Parmi ces facteurs de risque, on trouve notamment le sexe féminin et l'âge, car les structures musculaires se modifient naturellement au cours du processus de vieillissement. Les femmes qui ont donné naissance à des enfants sont particulièrement exposées, car le processus d'accouchement affaiblit le plancher pelvien. Une pression accrue dans la cavité abdominale, par exemple en cas de surpoids ou de toux chronique, peut également favoriser le prolapsus de la vessie.
Le diabète fait également partie des facteurs de risque, car cette maladie peut également affecter les nerfs. On parle alors de neuropathie diabétique. Si cette altération touche les nerfs qui innervent le plancher pelvien, cela peut entraîner un affaiblissement des muscles.
Symptômes en cas de descente de la vessie
Le symptôme le plus fréquent en cas de descente de la vessie est l'incontinence à l'effort. Les patientes concernées ressentent un besoin plus fréquent d'uriner et peuvent perdre involontairement de l'urine, notamment lors d'efforts (course, éternuement, toux, rire). En cas d'incontinence à l'effort, l'urètre est généralement également touché par la descente de la vessie.
Dans certains cas, seul le fond de la vessie descend, tandis que le col de la vessie et l'urètre restent en place. Il peut alors se produire un pli de l'urètre et les patientes se plaignent de troubles de la vidange vésicale, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas toujours vider complètement leur vessie et qu'il reste de l'urine résiduelle. Cela favorise à son tour l'apparition d'infections telles que les cystites.
Si le fond de la vessie s'affaisse fortement, cela peut également entraîner des envies fréquentes d'uriner. Les patientes ont alors plus souvent envie d'uriner et urinent très souvent de petites quantités d'urine. C'est ce qu'on appelle la pollakiurie. Comme les organes glissent généralement un peu vers l'arrière en position couchée, les symptômes s'améliorent surtout la nuit.
Les patientes rapportent également une sensation de pression désagréable dans la région pelvienne et parfois des douleurs lors des rapports sexuels. Cela se produit particulièrement souvent en cas de descente simultanée de l'utérus.
Comment diagnostiquer un prolapsus de la vessie?
Le diagnostic d'un prolapsus de la vessie commence toujours par une anamnèse détaillée. Celle-ci permet de déterminer la nature exacte des symptômes. Il est également très important de recueillir des informations sur les antécédents médicaux ou les facteurs de risque éventuels. L'examen des organes de l'appareil génito-urinaire est ensuite réalisé. Cela comprend un examen vaginal général à l'aide d'instruments, appelés spéculums, ainsi qu'un examen palpatoire. L'examen est effectué à la fois au repos et pendant que la patiente effectue un effort de poussée.
Ensuite, une échographie est généralement réalisée, au cours de laquelle la sonde est d'abord insérée dans le vagin (échographie transvaginale). La vessie peut ensuite être examinée par échographie à travers la paroi abdominale. Il est judicieux d'examiner d'abord la vessie lorsqu'elle est pleine, puis après la miction. Cela permet de déterminer la quantité d'urine résiduelle. Un diagnostic échographique complet en cas de descente de vessie comprend également un examen des reins.
En règle générale, le diagnostic de descente de vessie peut être posé après ces examens. Dans certains cas, des examens urodynamiques supplémentaires sont toutefois nécessaires. Il s'agit de procédures qui consistent généralement à prendre des images pendant la miction à l'aide d'un produit de contraste. Cela permet d'identifier les troubles de l'écoulement urinaire.
Afin de diagnostiquer une éventuelle infection urinaire, il peut également être utile de prélever un échantillon d'urine.
Traitement du prolapsus vesical
Le traitement du prolapsus vésical se divise en deux catégories: les mesures conservatrices et les mesures chirurgicales. Le type de traitement dépend principalement de la gravité de la maladie et des symptômes présentés par la patiente. En règle générale, on privilégie d'abord les mesures conservatrices et, en l'absence d'amélioration, on envisage une intervention chirurgicale.
Traitement conservateur
Parmi les options thérapeutiques conservatrices, il existe d'une part la possibilité d'un entraînement ciblé du plancher pelvien. Il s'agit d'une thérapie à long terme qui est utile aussi bien au stade initial qu'au stade avancé et après une opération. Les exercices doivent être appris sous la direction d'un kinésithérapeute spécialisé et répétés régulièrement à domicile. L'utilisation d'une électrostimulation ciblée peut soutenir les mesures kinésithérapeutiques.
Il est important de faire preuve d'une certaine patience lors de l'entraînement du plancher pelvien, car les résultats à court terme sont généralement plutôt modestes et les patientes tirent davantage profit de l'entraînement à long terme.
Une autre possibilité consiste à insérer un pessaire dans le vagin. Il s'agit d'un anneau en plastique ou en silicone destiné à apporter plus de stabilité. Il est inséré dans le vagin et positionné à la jonction avec le col de l'utérus (portio) de manière à soulever l'utérus et, par conséquent, la vessie. Comme leur port prolongé peut entraîner des escarres, les pessaires ne sont pas adaptés à une utilisation à long terme.
Afin d'éviter le dessèchement des muqueuses du vagin et de la paroi vésicale, un traitement local à base de crème contenant des œstrogènes doit être effectué, en particulier chez les femmes ménopausées.
Si les mesures conservatrices ne permettent pas d'améliorer suffisamment les symptômes, il est encore possible de recourir à la chirurgie.
Chirurgie du prolapsus vesical
Cette désignation ne fait pas référence à une technique chirurgicale spécifique. En effet, selon la patiente, une technique et une opération différentes peuvent être nécessaires. Les facteurs importants à prendre en compte sont l'étendue du prolapsus vésical, les symptômes qu'il provoque et le désir éventuel d'avoir des enfants.
En principe, les mesures chirurgicales ont pour objectif de raffermir le tissu conjonctif qui maintient les organes dans le bassin (vessie, utérus, rectum) et d'assurer ainsi une plus grande stabilité. En cas d'incontinence à l'effort en plus du prolapsus de la vessie, la procédure doit toujours traiter les deux symptômes.
L'intervention la plus courante consiste en l'ablation complète de l'utérus et ne convient donc qu'aux patientes qui n'ont plus l'intention d'avoir d'enfants. On parle alors d'hystérectomie. Dans la plupart des cas, l'accès se fait par le vagin. Après l'ablation de l'utérus, la paroi vaginale est séparée de la paroi vésicale, puis le tissu conjonctif de la paroi vésicale est raffermi. Cela permet de relever le plancher vésical.
Il peut également être nécessaire de séparer la paroi vaginale postérieure de l'adhérence conjonctive avec le côlon (rectum), puis de fixer le vagin. Comme il existe un risque que les parois vaginales adhèrent à nouveau à la paroi vésicale ou intestinale après un certain temps, un filet spécial peut être inséré pour éviter cela.
Pour traiter une incontinence à l'effort concomitante, l'urètre peut également être fixé à l'aide d'une bandelette en plastique. Dans certains cas, cela peut nécessiter une intervention par la paroi abdominale, appelée laparoscopie (examen de l'abdomen).
La procédure chirurgicale peut être modifiée et adaptée en fonction des résultats de l'examen et des souhaits de la patiente. Si celle-ci souhaite encore avoir des enfants, par exemple, il est possible de renoncer à l'ablation de l'utérus et de se contenter de séparer la paroi vaginale de la vessie. Cette décision est prise au cas par cas, en concertation avec le médecin traitant.
Comment prévenir le prolapsus vésical?
La prévention du prolapsus vésical consiste à contrôler les facteurs de risque et à renforcer ainsi le plancher pelvien. Étant donné que les facteurs de risque importants tels que le sexe ou l'âge ne peuvent être influencés, il convient de se concentrer sur le contrôle des facteurs influençables.
À cet égard, la gymnastique postnatale régulière après l'accouchement revêt une importance particulière. Elle peut être commencée environ 6 à 8 semaines après l'accouchement et vise à renforcer les muscles du plancher pelvien, du tronc et de l'abdomen.
De plus, l'entraînement ciblé des muscles du plancher pelvien, indépendamment de l'accouchement, est une mesure extrêmement utile pour prévenir le prolapsus de la vessie. Il convient également de normaliser son poids et de bien contrôler un éventuel diabète.
Quel médecin peut aider en cas de descente de vessie?
Bien que la descente de vessie soit une maladie des voies urinaires qui relève en fait du domaine de l'urologie, c'est généralement le gynécologue qui est le premier interlocuteur des patientes concernées. Ceux-ci sont spécialisés dans le diagnostic et le traitement des changements de position des organes urogénitaux féminins et sont donc les praticiens les plus compétents.
Nous vous aidons à trouver un expert pour votre maladie. Tous les médecins et cliniques répertoriés ont été contrôlés par nos soins pour leur spécialisation exceptionnelle dans le domaine du prolapsus de la vessie et attendent votre demande ou votre souhait de traitement.